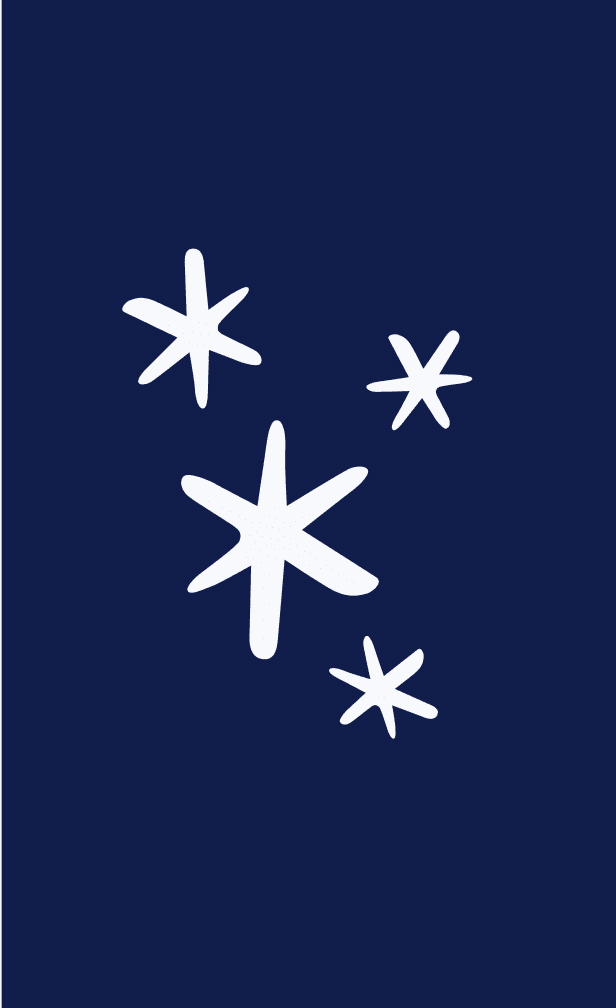Même univers, zéro spoiler : l’expérience propose une enquête immersive où chaque participant devient protagoniste. Écrire une Murder Party n’est pas la même chose qu’écrire un roman traditionnel. Entre méthodes « jardinier » et « architecte », voici pourquoi le jeu exige une véritable architecture narrative : intrigues multiples planifiées, personnages tous principaux, révélations cadencées, happenings et croisements scénaristiques soigneusement pensés en amont.
Écrire une Murder Party vs écrire un roman
À l’occasion de la sortie de Nos Âmes Consumées, l'équipe du label young adult Comet et Murderama co-créent une Murder Party sur mesure pour un événement influenceurs.
Pourquoi comparer roman et Murder Party ?
Roman et Murder Party manipulent la même matière — personnages, secrets, révélations, émotions — mais poursuivent des objectifs radicalement différents.
- Le roman est une expérience linéaire, intime, méditative. L’auteur contrôle le rythme : il choisit quand vous apprendrez quoi.
- La Murder Party est une expérience interactive et collective. Elle se déroule en temps réel, dans un lieu, avec des dizaines de décisions imprévisibles. L’auteur-metteur en jeu perd une partie du contrôle… pour la donner aux joueurs.
Comparer ces deux formes permet de comprendre une évidence discrète : plus l’expérience est ouverte aux choix du public, plus la structure doit être préparée à l’avance. C’est là que l’architecte entre en scène.
Deux approches d’auteur : « jardinier » et « architecte »
Le « jardinier »
Le jardinier part d’une idée-graine, une image, une réplique, une atmosphère. Il écrit pour découvrir l’histoire en avançant, acceptant d’élaguer des branches, de replanter ailleurs.
L’« architecte »
L’architecte commence par le plan : arcs, jalons, symétries, fil des révélations. Il orchestre la montée en tension, place des fondations (motivations), des poutres (intrigues), des circulations (indices).
Beaucoup d’auteurs sont hybrides. On peut jardiner à l’échelle de la scène, tout en respectant une architecture globale. Cette hybridation est ce qui se passe naturellement dans une Murder Party : l’auteur met en place des enjeux et des intrigues et les joueurs font vivre leur personnages avec leur choix et leurs propres déroulés.
Pourquoi la Murder Party est (presque toujours) un travail d’architecte
Dans un roman, un lecteur suit un fil. Dans une Murder Party, 5, 10, parfois 20 fils se déroulent en parallèle. Chacun doit vivre une histoire complète et lisible, au même moment, dans le même espace. Cela impose d’anticiper :
- La multi-centralité : chaque joueur est protagoniste de son propre arc. Aucun « figurant ».
- La synchronisation : indices, timings, scènes (happenings) déclenchées à des moments précis.
- La robustesse : prévoir les bifurcations, les plans B/C lorsque les joueurs surprennent le scénario (et ils le feront !).
Bref, la Murder Party exige une architecture généreuse : suffisamment solide pour tenir debout, suffisamment souple pour accueillir l’imprévu.
Anatomie d’une Murder Party
Des personnages « tous principaux »
Chacun reçoit une fiche-rôle avec objectifs, leviers d’action, relations clés. L’enjeu n’est pas d’offrir « le rôle principal » à un seul, mais un arc gratifiant à tous : une quête, un dilemme, un choix à poser.
Des intrigues multiples prévues en amont
On vise un équilibre : 1 intrigue centrale + 2 à 3 sous-intrigues fortes. Ainsi, plusieurs dynamiques coexistent : enquête, diplomatie, romance, pouvoir, héritage, etc. Ces couches offrent des portes d’entrée variées aux profils de joueurs.
Des révélations cadencées
Le temps réel exige un pacing clair, souvent en trois actes :
- Acte I — Mise en jeu : découverte du monde, des objectifs, premières tensions.
- Acte II — Montée : indices cruciaux, alliances, retournements intermédiaires.
- Acte III — Convergence : dernière fenêtre d’enquête, révélation finale, résolution.
Public/privé : alterner révélations collectives (qui relancent tout le monde) et informations intimes (qui attisent des actions ciblées).
Happenings & croisements scénaristiques
Les happenings sont des événements : une lettre surgit, une salle s’ouvre, un message audio est décodé, un PNJ intervient. Les croisements sont les ponts entre intrigues : une info découverte dans l’arc A renverse un enjeu dans B et libère une action dans C. Cette capillarité se planifie : c’est la signature de l’architecte.
Étude courte (sans spoiler) : Murmures au Manoir, inspirée de Nos Âmes Consumées
Positionnement. L’expérience partage l’atmosphère et certains motifs thématiques du roman (héritages, secrets, voix du passé), sans révéler l’intrigue du livre. Le décor : un gala caritatif dans un manoir en 1986. Sous la surface, un meurtre, un possible trésor, un cercle de pierres païen, des disparitions. Architecture.
- Intrigue centrale : élucider la mort au coeur de la soirée — et ce qu’elle déclenche dans la communauté réunie.
- Sous-intrigues : Trésor à retrouver, dette cachée, amours contrariées, disparition d’Octave.
- Réseau relationnel : familles, amis, adversaires ; triangles et pactes. On organise les liens comme un plan de circulation : chaque relation ouvre une scène potentielle.
- Révélations : jalonnées (indices matériels, témoignages contradictoires, lieux débloqués), avec un final lisible par tous.
- Happenings : annonce officielle, toast, lecture d’une cassette, enchères.
Résultat : une expérience multi-centrée où chaque joueur défend son arc — tout en faisant avancer la résolution commune.
Roman vs Murder Party : le tableau qui clarifie tout
Pour aller plus loin :
● En savoir plus sur Murderama : Découvrez les scénarios jouables partout en France.